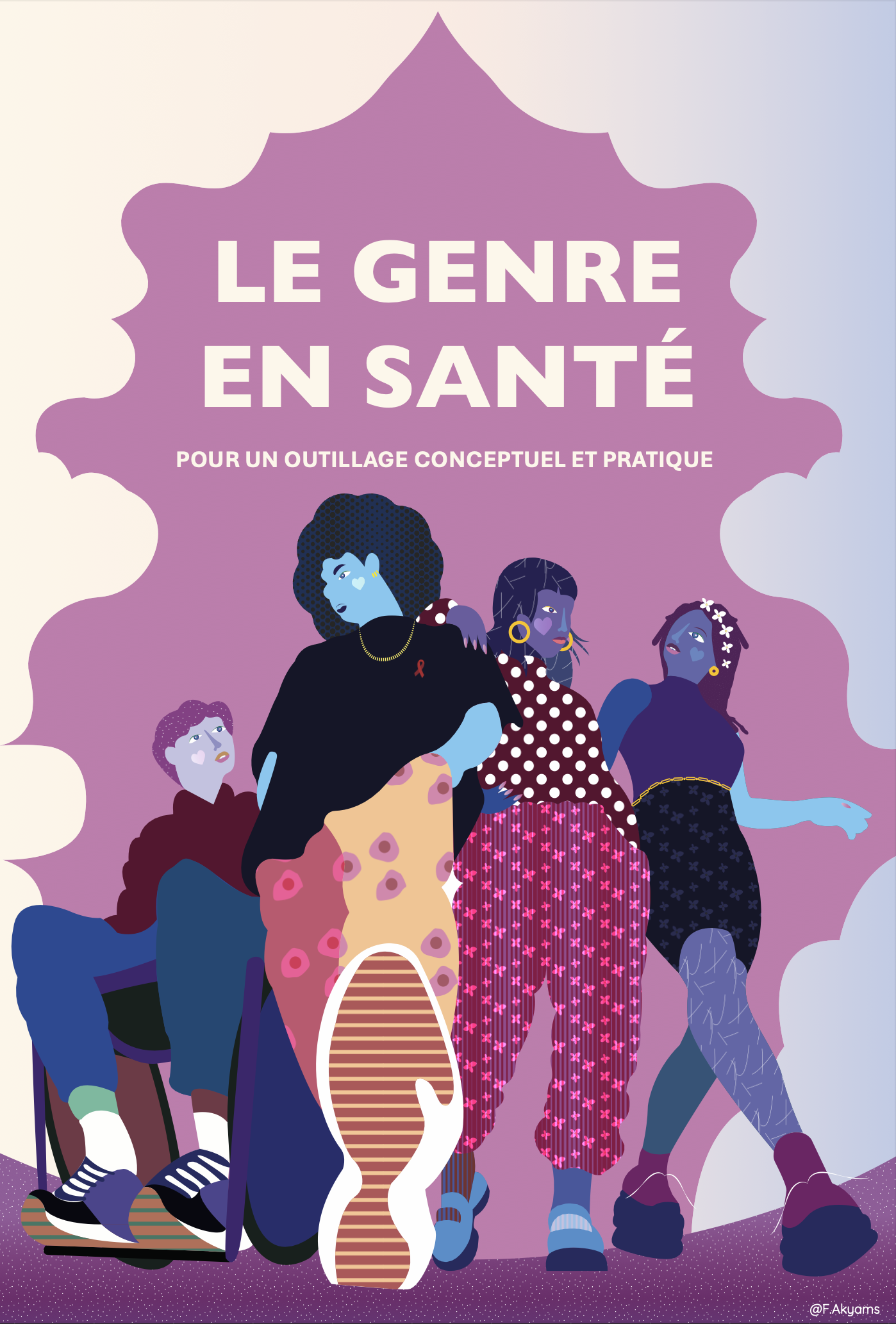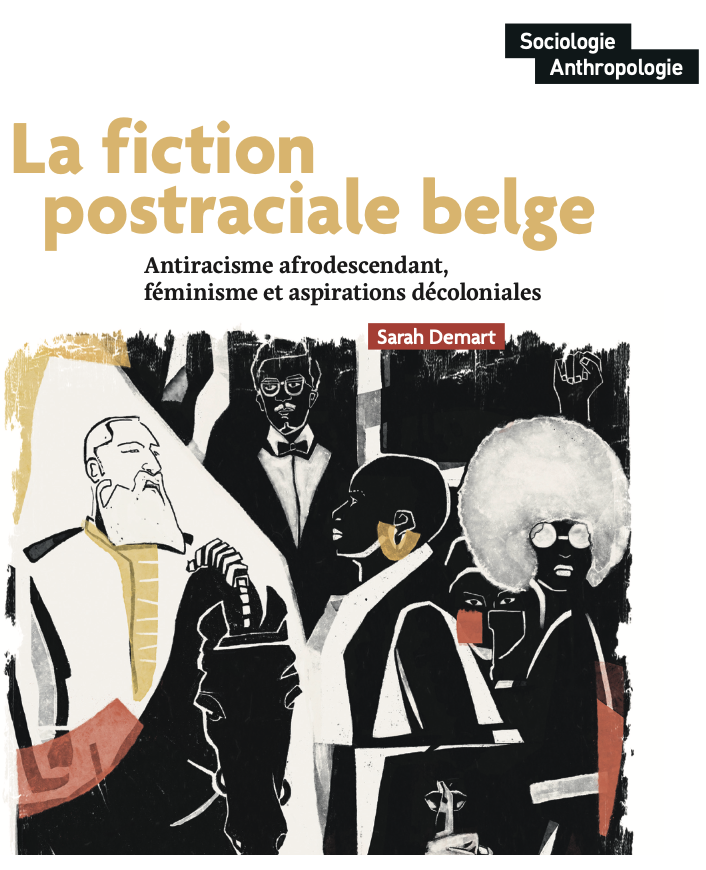Journée d’étude : Enquête sur les discriminations dans le milieu médical envers les personnes vivant avec le VIH
Malgré les avancées médicales et les campagnes de sensibilisation, l’accès aux soins de santé pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) reste marqué par des discriminations et des stigmatisations persistantes dans le domaine des soins dentaires et gynécologiques. La Plateforme Prévention Sida (PPS) en collaboration avec l’Observatoire du sida et des sexualités de l’Université Plus d’infos