Brèves
LA FICTION POSRACIALE BELGE. ANTIRACISME AFRODESCENDANT, FEMINISME ET ASPIRATIONS DECOLONIALES.
Le nouveau livre de Sarah Demart, soiciologue et chercheure de l’Observatoire du Sida et des Sexualités, vient d’être publié aux Éditions de l’Université de Bruxelles.
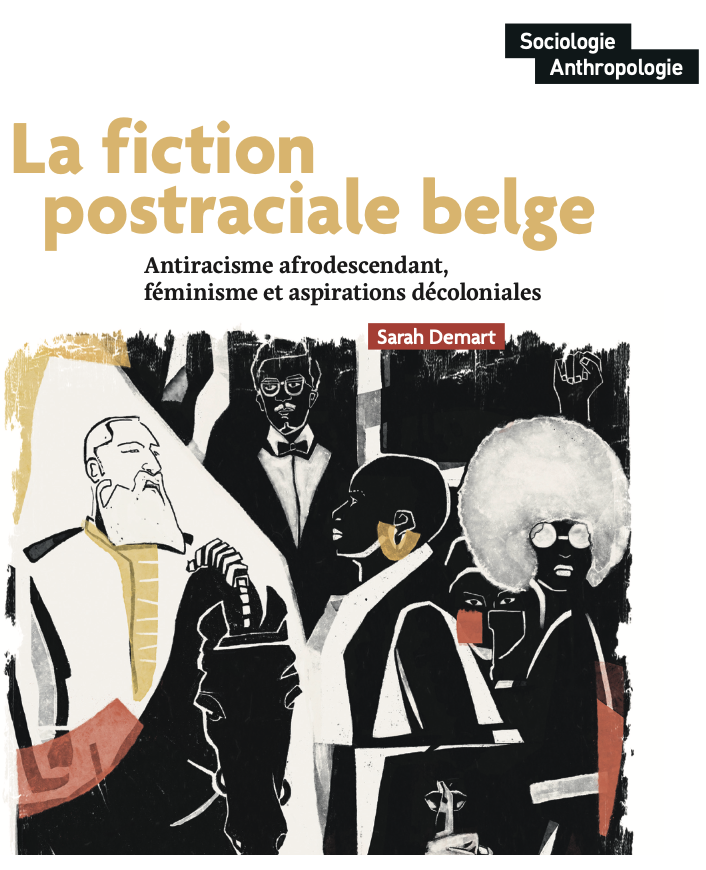
La fiction postraciale est l’idée selon laquelle le racisme est une affaire individuelle et/ou une idéologie relevant au mieux de l’aberration, au pire de l’extrémisme. Elle est ce qui fonde les pensées antiracistes dominantes et empêche de penser le racisme à partir du projet colonial des États européens et de la longue histoire impérialiste occidentale.
Depuis maintenant plusieurs années, la fiction d’une ère postraciale fait l’objet de virulentes contestations, eu égard à l’ignorance et au déni dont elle procède. Cela se traduit par une fracture profonde dans l’antiracisme, qui se cristallise autour de cette question : quelle place accorder au racisme anti-Noir·es et au colonialisme dans les politiques européennes de lutte contre le racisme ?
À partir du cas particulier de la Belgique francophone et d’une ethnographie de longue durée au sein des milieux militants (2011-2019), cet ouvrage examine de manière fine les conditions de possibilité d’un antiracisme afrodescendant. Les différentes conversations antiracistes qu’engage la reconnaissance du racisme anti-Noir·es sont ainsi examinées à plusieurs niveaux : microsocial (rapports interpersonnels), mésocial (organisations) et macrosocial (cadre institutionnel et poli- tique). Elles sont restituées à l’appui d’une sociologie critique nourrie par les épistémologies féministes, noires et postcoloniales/décoloniales et par l’étude de l’ignorance et de la race.
TABLE DES MATIERES
Introduction
Angela Davis à Bruxelles, le momentum Black Lives Matter et la non-performativité de la discussion antiraciste belge
Méthodologie
L’ancrage congolais : un point de départ épistémique • La décennie 2010 • Le non-sujet académique • Le pluralisme militant, le tournant féministe et l’unité politique • Des revendications postcoloniales aux conditions de possibilité d’un militantisme antiraciste • De la sortie du terrain militant
Chapitre I – La fiction postraciale
L’innocence blanche entachée de la Belgique • La temporalité eurocentrée de l’antiracisme mainstream • La contre-généalogie de la race • De la surenchère victimaire des Noir·es ?
Chapitre II – Négocier sa place dans l’antiracisme mainstream
L’égalité des chances et la lutte contre le racisme • Les Assises de l’interculturalité et la mise à l’agenda de la mémoire coloniale • Le MRAX et l’antiracisme porté par les racisé·es • L’offre d’alliance et le procès d’instrumentalisation • À la recherche d’un cadre de référence commun à l’antiracisme francophone • Le compromis antiraciste mainstream francophone • L’inégalité matérielle des conditions de participation à la discussion antiraciste • BePax et la construction d’une expertise antiraciste connectée aux milieux militants • BePax en crise : le coût institutionnel de la transformation antiraciste
Chapitre III – L’antiracisme d’État et les compromis à la belge
La société civile mobilisée pour un plan national de lutte contre le racisme • Le plan NAPAR et les associations afrodescendantes et noires • La Décennie des personnes d’ascendance africaine et la politique de négligence • L’antiracisme d’État et le racisme anti-Noir·es • Les contraintes d’un cadre législatif obsolète • Le blackface et l’impossible pénalisation du racisme anti- Noir·es • Unia comme intermédiaire d’une loi antiraciste obsolète • L’indépendance de l’antiracisme d’État et le compromis politique
Chapitre IV – La démocratie culturelle et l’effacement de la race
L’action culturelle comme cadre de l’antiracisme • Le racisme anti-Noir·es : une affaire réglée… vraiment ? • La démocratie culturelle et le malencontreux oubli du colonialisme ? • Le soupçon de communautarisme et la blanchité de l’antiracisme • La diversité et l’effort de transformation de l’antiracisme mainstream • La répartition des ressources de l’antiracisme et la ligne raciale • Lutter par le bas : la rémunération des interventions militantes • Se désengager du travail gratuit • Le tournant afroféministe et la repolitisation de l’argent • La revendication d’une expertise et d’une justice épistémique
Chapitre V – Les allié·es
Politiser la blanchité • Des allié·es aux complices ? • L’identification des allié·es et l’argument d’utilité • La réduction instrumentale et la privatisation des allié·es • De l’impossible discussion publique avec les allié·es complices ? • Les Maghrébin·es : des allié·es ?
Chapitre VI – La race versus l’unité
politique et militante La politique de représentation de la blackness et l’espace militant • La blanchité de l’espace militant • Le sujet politique noir et le mandat communautaire • Militantisme et blackness • Les concurrences intermilitantes • La conscience politique noire et la stratégie militante • Les tensions congolo- rwandaises : politique de la blackness et africanité • L’entrepreneuriat militant et les rapports de loyauté
Conclusion



