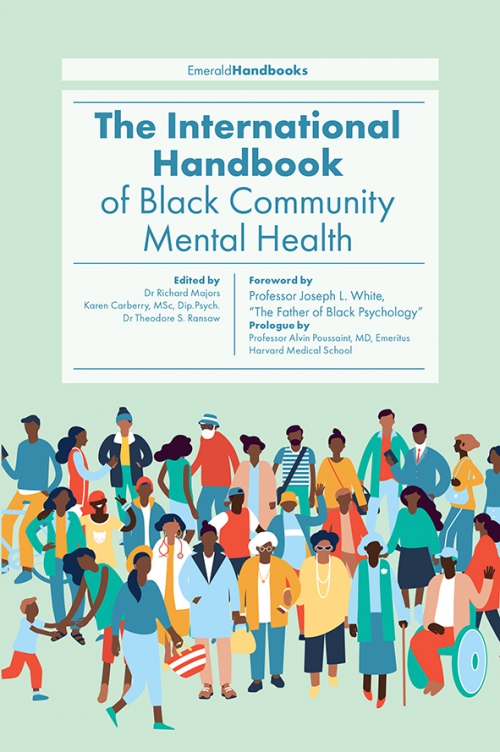Le centre de documentation
et le catalogue SEXSI
Le centre de documentation de l’Observatoire du sida et des sexualités est spécialisé dans la prévention du VIH/IST et plus largement, les questions de santé, de sexualité et de genres, de races et de migration. Cette documentation est mise à disposition des professionnel·les de terrain et scientifiques du domaine de la promotion de la santé à travers un espace de consultation, situé dans les locaux de l’Université Saint-Louis.
Les ouvrages disponibles au centre de documentation sont répertoriés dans le catalogue SEXSI.
Centre de documentation
de l’Observatoire du sida et des sexualités
observatoire-sidasexualites@ulb.be
02 650 30 55
Accueil sur rendez-vous
Nouveautés (septembre 2020)
Le Congo colonial. Une histoire en questions
Idesbald Goddeeris, Amandine Lauro, Guy Vanthemsche (dir.) (2020) Le Congo colonial. Un histoire en questions, Waterloo : Renaissance du Livre, 464 p.
Le colonialisme suscite aujourd’hui bon nombre de débats souvent passionnés et parfois marqués par leur méconnaissance des faits et du contexte. C’est pourquoi Le Congo colonial souhaite présenter les résultats de la recherche actuelle et les connaissances scientifiques d’aujourd’hui à un large public, et développer ainsi une nouvelle vision globale de la thématique. À l’aide de questions concrètes, des historiens offrent un aperçu unique sur le passé colonial belge.
Comment l’administration autocratique de Léopold II a-t-elle fonctionné et que savons-nous des victimes ? Combien de profits ont été réalisés au Congo et à qui ont-ils été versés ? Comment les Congolais, hommes et femmes, ont-ils vécu la colonisation ? Comment ont-ils résisté ? Quel fut l’impact du colonialisme sur la nature ? Quelles ont été les conséquences de la politique coloniale en matière d’infrastructure, d’éducation, de santé et de science ? Les missionnaires ont-ils donné au colonialisme un visage plus humain ?
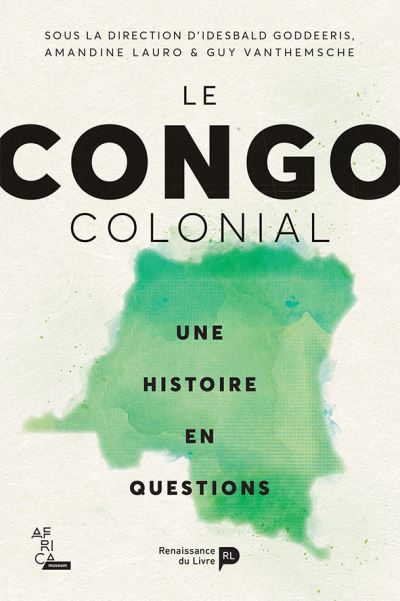
Le sexe et ses doubles. (Homo)sexualités en postcolonie
Patrick Awondo (2019) Le sexe et ses doubles. (Homo)sexualités en postcolonie, Lyon : ENS Éditions, coll. « Sociétés, espaces, temps », 248 p.
Au cours des deux dernières décennies, la question de l’orientation sexuelle et des identités de genre est devenue un sujet de débat public dans de nombreux pays africains. En lien avec la montée des violences anti-homosexuelles dans les années 2000, la recherche en sciences sociales s’est attelée à montrer que l’Afrique, soudainement homophobe, fut pendant longtemps un lieu de tolérance pour la diversité sexuelle, à condition qu’elle reste confinée dans l’espace privé. Dans ce contexte, sur la base d’une double enquête ethnographique au Cameroun et en France, Patrick Awondo analyse l’émergence de l’homosexualité comme sujet politique et son expression dans les parcours des « migrants sexuels » africains en France. Cet ouvrage propose ainsi un traitement ethnographique de la naissance d’un militantisme homosexuel en Afrique sub-saharienne postcoloniale et de la construction de l’homosexualité comme question publique dans un contexte plus général d’« ensauvagement » de la société africaine.
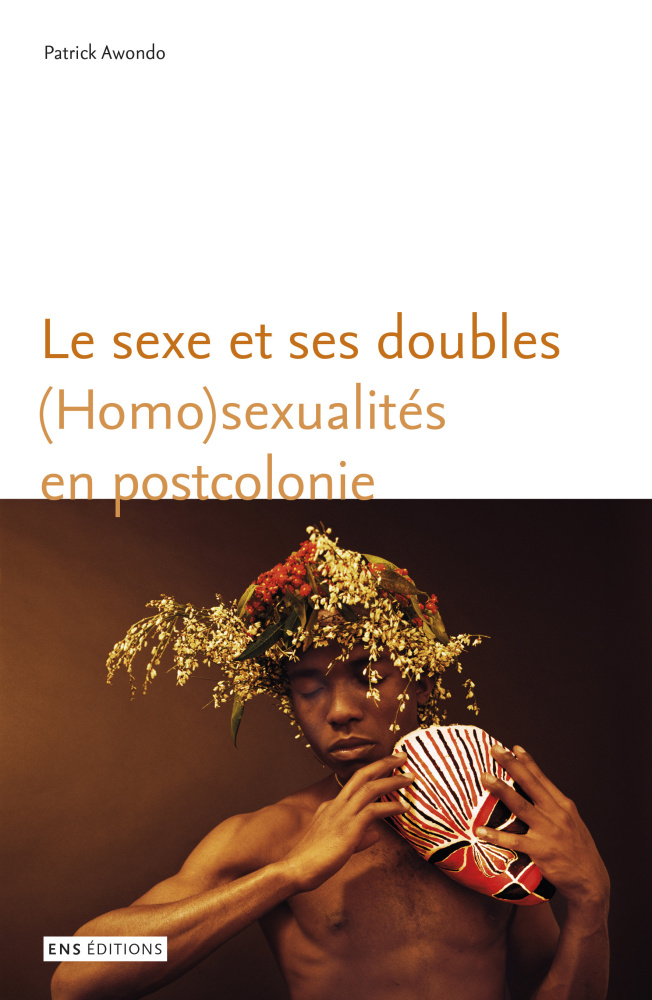
Sexualités, identité & corps colonisés
Gilles Boëtsch, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Sylvie Chalaye, Fanny Robles, T. Denean Sharpley-Whiting, Jean-François Staszak, Christelle Taraud, Dominic Thomas, Naïma Yahi (dir.) (2019) Sexualités, identité & corps colonisés. XVe siècle – XXIe siècle, Paris : CNRS, col. « Corps », 667 p.
Longtemps passées sous silence, la sexualité dans les empires coloniaux et la domination sur les corps apparaissent aujourd’hui comme des sujets de recherches majeurs. Les héritages de cette histoire font désormais débats dans nos sociétés de plus en plus métissées et mondialisées. Six siècles d’histoire ont construit des imaginaires, des fantasmes et des pratiques analysés dans cet ouvrage au fil des cinquante contributions de spécialistes internationaux. Coordonné par un collectif paritaire de dix chercheur.e.s de plusieurs disciplines, l’ouvrage Sexualités, identités et corps colonisés tisse des liens entre passé et présent, et explore les nombreuses facettes de cette histoire. La publication de Sexe, race & colonies en 2018 a initié débats et polémiques, mais a aussi reçu un écho sans précédent. Ce nouveau livre va plus loin.
Aux quinze articles majeurs du précédent ouvrage, réédités pour les rendre accessibles au plus grand nombre, ont été ajoutées trente contributions inédites éclairant la transversalité de cette question dans tous les empires coloniaux jusqu’aux sociétés postcoloniales actuelles. Ce livre permet de saisir comment la sexualité et les hiérarchies raciales ont été consubstantielles à l’organisation du pouvoir dans les empires et à l’invention d’imaginaires transnationaux. Déconstruire les regards coloniaux qui sont omniprésents dans nos représentations suppose de regarder en face cette hégémonie sexuelle mondialisée et ce passé, aussi complexe soit-il. C’est à ce prix qu’une décolonisation des imaginaires sera possible.
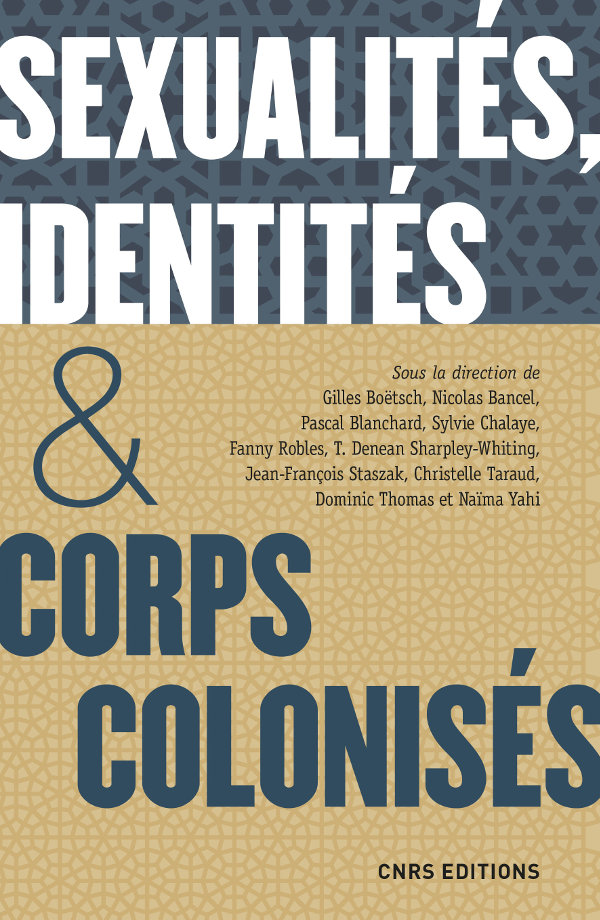
Sida. une Écriture au Feminin
Florence Lhote, Nicolas Balutet (dir.) (2019) Sida. une Écriture au Feminin, Paris : Sipayat, collection « Essais », 126 p.
Les « années-Sida » décrivent ce moment charnière, à partir de la découverte du virus en 1981, où le soupçon et le jugement moral deviennent emprises, moyen de contrôler l’individuel à des fins collectives, où l’intime devient politique. Les morts s’enchaînent et frappent tous les âges, ingrates.
Que reste-t-il de ces années-là ? Que savons-nous de l’épidémie du Sida aujourd’hui ? Comment prendre en charge ce récit ? Doit-on en avoir été témoin, s’être engagé dans ces nouvelles formes d’activisme collectif pour les saisir ?
Cet ouvrage interroge l’écriture de cette histoire à distance, une écriture qui vient de débuter et qui est surtout le lieu d’une « épidémie de la représentation » pour Élisabeth Lebovici. Au sein de cette multitude de représentations du virus, cet ouvrage prend le parti de plonger dans les voix féminines. Longtemps invisibilisées, il retrace la lente éclosion d’une parole rendant justice aux solidarités militantes que l’épidémie a vu naître.
Mais au travers des carences de la parole d’État peut aussi se faire jour une police de la pensée de l’épidémie, une « gentrification des esprits » selon Sarah Schulman. L’histoire narrée est-elle fidèle aux engagements d’alors ? Ce livre choisit volontairement, pour y répondre, une perspective transdisciplinaire : littérature, histoire des arts, anthropologie, muséologie et art-thérapie.
Car, dans cette histoire étant en cours d’écriture, s’interroger sur ce récit collectif et ses traces relève alors de notre patrimoine commun.
Notre documentaliste vous accueille sur rendez-vous. Retrouvez tous les ouvrages disponibles dans le catalogue en ligne.
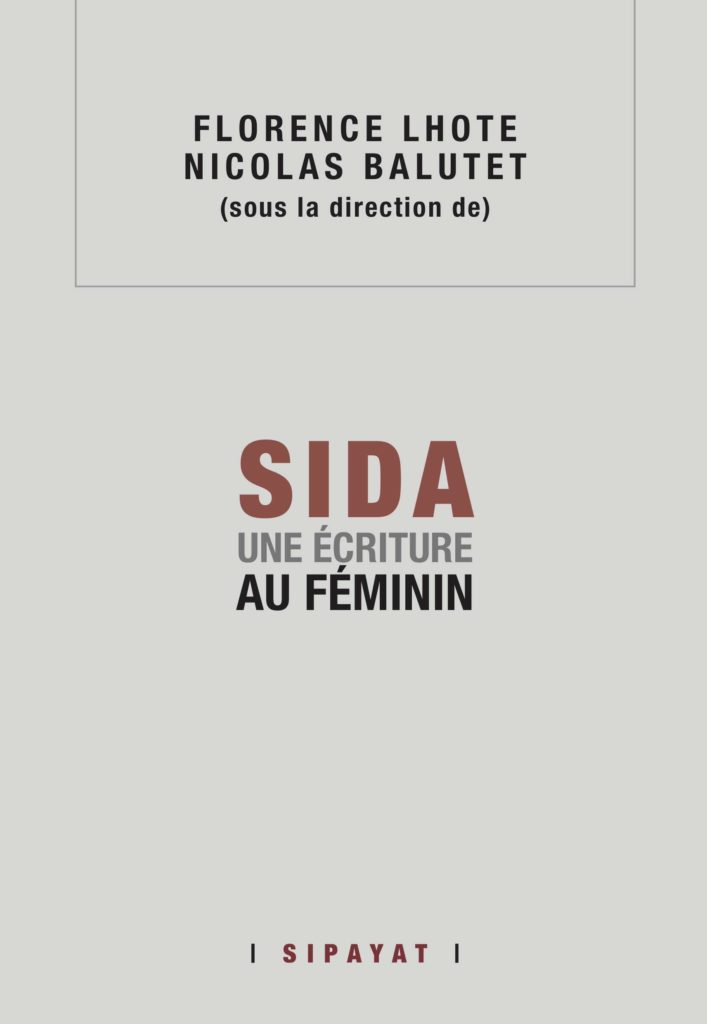
The International Handbook of Black Community Mental Health
Richard Majors, Karen Carberry and Theodore Ransaw (ed.) (2020) The International Handbook of Black Community Mental Health, Bingley : Emerald Publishing Limited, 640 p.
Ce manuel international sur la santé mentale de la communauté noire aborde des questions clés, notamment les stéréotypes en matière de santé mentale, les erreurs de diagnostic et les inégalités/la discrimination en matière d’accès, de services et de prestations. Le livre couvre de nombreux aspects de la santé mentale et du développement tels que la schizophrénie, les troubles de santé mentale, les TSA et le TDAH, mais il s’intéresse également à des domaines plus controversés, tels que les inégalités, le racisme et la discrimination, tant dans la pratique des professionnel·les de la santé mentale que dans la formation et les expériences de supervision des étudiants noirs. Le livre présente de nombreux témoignages de thérapeutes et d’étudiants noirs. Alors que le racisme institutionnel est un problème majeur tant dans la société que dans les universités, les éditeurs de ce manuel analysent le racisme au niveau personnel, la micro-agression et le racisme vécu au quotidien, comme modèle pour comprendre et analyser les expériences d’interaction/communication racialisées à l’université, ainsi que les communications et les inégalités racialisées dans le secteur de la santé mentale.